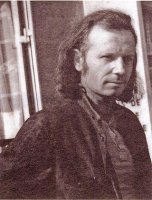Qu’est-ce que, pour toi, « l’anthropologie politique » ? Comment te situes-tu dans ta démarche ethnologique actuelle (notamment par rapport au structuralisme) ?
La question du structuralisme d’abord. Je ne suis pas structuraliste. Mais ce n’est pas que j’aie quoi que ce soit contre le structuralisme, c’est que je m’occupe, comme ethnologue, de champs qui ne relèvent pas d’une analyse structurale à mon avis ; ceux qui s’occupent de parenté, de mythologie, là apparemment ça marche, le structuralisme, et Lévi-Strauss l’a bien démontré que ce soit quand il a analysé les structures élémentaires de la parenté, ou les mythologiques. Ici je m’occupe, disons, en gros, d’anthropologie politique, la question de la chefferie et du pouvoir, et là j’ai l’impression que ça ne fonctionne pas ; ça relève d’un autre type d’analyse. Maintenant ceci dit, il est très probable que si je prenais un corpus mythologique je serais forcément structuraliste parce que je ne vois pas très bien comment analyser un corpus mythologique d’une manière extra-structuraliste… ou alors faire des sottises, genre la psychanalyse du mythe ou la marxisation du mythe — « Le mythe, c’est l’opium du sauvage » — mais ça, ce n’est pas sérieux.
Tu ne renvoies pas seulement à la société primitive ; ton interrogation sur le pouvoir est interrogation sur notre société. Qu’est-ce qui fonde ta démarche ? Qu’est-ce qui justifie le passage ?
Le passage, il est impliqué par définition. Je suis ethnologue, c’est-à-dire que je m’occupe des sociétés primitives, plus spécialement de celles d’Amérique du Sud où j’ai fait tous mes travaux de terrain. Alors là, on part d’une distinction qui est interne à l’ethnologie, à l’anthropologie, les sociétés primitives, qu’est-ce que c’est ? Ce sont les sociétés sans État. Forcément parler de sociétés sans État c’est nommer en même temps les autres, c’est-à-dire les sociétés à État. Où est le problème ? De quelle manière il m’intéresse, et pourquoi j’essaie de réfléchir là-dessus ? C’est que je me demande pourquoi les sociétés sans État sont des sociétés sans État et alors il me semble m’apercevoir que si les sociétés primitives sont des sociétés sans État c’est parce qu’elles sont des sociétés de refus de l’État, des sociétés contre l’État. L’absence de l’État dans les sociétés primitives ce n’est pas un manque, ce n’est pas parce qu’elles sont l’enfance de l’humanité et qu’elles sont incomplètes, ou qu’elles ne sont pas assez grandes, qu’elles ne sont pas adultes, majeures, c’est bel et bien parce qu’elles refusent l’État au sens large, l’État défini comme dans sa figure minimale qui est la relation de pouvoir. Par là même parler des sociétés sans État ou des sociétés contre l’État, c’est parler des sociétés à État, forcément le passage, il n’y en a même pas, ou il est d’avance possible ; et la question qui s’enracine dans le passage, c’est : d’où sort l’État, quelle est l’origine de l’État ? Mais c’est tout de même deux questions séparées : comment les sociétés primitives font-elles pour ne pas avoir l’État ? D’où sort l’État ?
Alors, « l’ethnologie politique » ? Si on veut dire « est-ce que l’analyse de la question du pouvoir dans les sociétés primitives, dans les sociétés sans État, peut nourrir une réflexion politique sur nos propres sociétés ? », certainement, mais ce n’est pas nécessaire. Je peux très bien m’arrêter à des questions sinon académiques, du moins de pure anthropologie sociale : comment la société primitive fonctionne-t-elle pour empêcher l’État ? D’où sort l’État ?
Je peux m’arrêter là, et rester purement et simplement ethnologue. D’ailleurs, en gros, c’est ce que je fais. Mais il n’y a pas de doute qu’une réflexion ou une recherche sur, en fin de compte, l’origine de la division de la société, ou sur l’origine de l’inégalité, au sens où les sociétés primitives sont précisément des sociétés qui empêchent la différence hiérarchique, une telle réflexion, une telle recherche peuvent nourrir une réflexion sur ce qui se passe dans nos sociétés. Et, là, d’ailleurs très vite on rencontre la question du marxisme.
Est-ce que tu pourrais préciser ? Quels sont tes rapports avec les ethnologues marxisants ?
Mes rapports avec ceux de mes collègues qui sont marxistes sont marqués par un désaccord au niveau de ce qu’on fait, au niveau de ce qu’on écrit, pas forcément au niveau personnel. La plupart des marxistes sont orthodoxes, je dis la plupart parce qu’il y en a qui ne le sont pas, heureusement ; mais ceux qui sont orthodoxes, ils s’en tiennent beaucoup plus à la lettre qu’à l’esprit. Alors la théorie de l’État, dans ce sens-là, qu’est-ce que c’est ? C’est une conception instrumentale de l’État, c’est-à-dire, l’État c’est l’instrument de la domination, de la classe dominante sur les autres ; à la fois dans la logique et dans la chronologie, l’État vient après, une fois que la société est divisée en classes, qu’il y a des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités ; l’État c’est l’instrument des riches pour mieux exploiter et mystifier les pauvres et les exploités. À partir de recherches et de réflexion qui ne quittent pas le terrain de la société primitive, de la société sans État, il me semble que c’est le contraire, ce n’est pas la division en groupes sociaux opposés, ce n’est pas la division en riches et pauvres, en exploiteurs et exploités, la première division, et celle qui fonde en fin de compte toutes les autres, c’est la division entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, c’est-à-dire l’État, parce que fondamentalement c’est ça, c’est la division de la société entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui subissent le pouvoir. Une fois qu’il y a ça, c’est-à-dire la relation commandement/obéissance, c’est-à-dire un type ou un groupe de types qui commandent aux autres qui obéissent, tout est possible à ce moment-là ; parce que celui qui commande, qui a le pouvoir, il a le pouvoir de faire faire ce qu’il veut aux autres, puisqu’il devient le pouvoir précisément, il peut leur dire « travaillez pour moi », et à ce moment-là l’homme de pouvoir peut se transformer très facilement en exploiteur, c’est-à-dire en celui qui fait travailler les autres. Mais la question est que, quand on réfléchit sérieusement à la manière dont fonctionnent ces machines sociales que sont les sociétés primitives, on ne voit pas comment ces sociétés-là peuvent se diviser, je veux dire, peuvent se diviser en riches et pauvres. On ne voit pas parce que tout fonctionne pour empêcher cela précisément. Par contre on voit beaucoup mieux, on comprend beaucoup mieux, enfin plusieurs questions obscures se clarifient, à mon avis, si on pose d’abord l’antériorité de la relation de pouvoir. C’est pourquoi il me semble que pour y voir plus clair dans ces questions il faut carrément renverser la théorie marxiste de l’origine de l’État — c’est un point énorme et précis en même temps — et il me semble que loin que l’État soit l’instrument de domination d’une classe, donc ce qui vient après une division antérieure de la société, c’est au contraire l’État qui engendre les classes. Cela peut se démontrer à partir d’exemples de sociétés à État non occidentales, je pense particulièrement à l’État inca dans les Andes. Mais on pourrait prendre aussi bien d’autres exemples parfaitement occidentaux, et puis même un exemple très contemporain c’est l’URSS.
Naturellement je simplifie, je ne suis pas russologue ni kremlinologue… mais enfin si on regarde massivement, vu d’un peu loin, mais pas de très loin, la révolution de 17, qu’est-ce qu’elle a fait ? Elle a supprimé les relations de classe, tout simplement en supprimant une classe : les exploiteurs, les bourgeois, les grands propriétaires, l’aristocratie et l’appareil d’État qui marchait avec tout ce qui était la monarchie, ce qui fait qu’il n’est resté qu’une société dont on pourrait dire qu’elle n’était plus divisée puisque l’un des termes de la division avait été éliminé, il est resté une société non divisée et par là-dessus une machine étatique (le parti aidant) détenant le pouvoir au bénéfice du peuple travailleur, des ouvriers et des paysans. Bon. Qu’est-ce que c’est que l’URSS actuelle ? Sauf si on est militant du parti communiste, auquel cas l’URSS c’est le socialisme, c’est l’État des travailleurs, etc., si on n’est pas dans la théologie et le catéchisme, si on n’est pas dans l’aveuglement et tout ce qu’on veut, l’URSS qu’est-ce que c’est ? C’est une société de classes, je ne vois pas pourquoi hésiter à utiliser ce vocabulaire, c’est une société de classes et une société de classes qui s’est constituée purement à partir de l’appareil d’État.
Il me semble qu’on voit bien là la généalogie des classes, c’est-à-dire des riches et des pauvres, des exploiteurs et des exploités, c’est-à-dire cette division-là, cette division économique de la société à partir de l’existence de l’appareil d’État. L’État soviétique, centré sur le parti communiste, a engendré une société de classes, une nouvelle bourgeoisie russe qui n’est certainement pas moins féroce que la plus féroce des bourgeoisies européennes au XIXe siècle, par exemple. Ça me parait sûr, et lorsque je dis cette chose qui a l’air surréaliste, à savoir que c’est l’État qui engendre les classes, on peut l’illustrer en prenant des exemples dans des mondes complètement différents de celui dans lequel on vit, à savoir les Incas ou l’URSS.
Or il est probable que des spécialistes, disons, de l’Égypte ancienne ou d’autres régions, ou d’autres cultures, des sociétés que Marx désignait sous le nom de despotisme asiatique ou d’autres sous le nom de civilisation hydraulique, je pense que les spécialistes de ces sociétés iraient, je suppose, dans le même sens que moi : ils montreraient comment à partir de la division politique s’engendre, d’ailleurs très facilement, la division économique, c’est-à-dire ceux qui obéissent deviennent en même temps les pauvres et les exploités, ceux qui commandent, les riches et les exploiteurs. C’est parfaitement normal parce que détenir le pouvoir c’est pour l’exercer ; un pouvoir qui ne s’exerce pas ce n’est pas un pouvoir ; et l’exercice du pouvoir par quoi passe-t-il ? Par l’obligation qu’on fait aux autres de travailler pour soi-même. Ce n’est pas du tout l’existence du travail aliéné qui engendre l’État mais je pense que c’est exactement le contraire : c’est à partir du pouvoir, de la détention du pouvoir que s’engendre le travail aliéné ; le travail aliéné qu’est-ce que c’est ? « Je travaille non pour moi, mais je travaille pour les autres » ou plutôt, « je travaille un peu pour moi et beaucoup pour les autres ». Celui qui a le pouvoir, il peut dire aux autres : « Vous allez travailler pour moi. » Et alors apparaît le travail aliéné ! La première forme et la forme la plus universelle du travail aliéné étant l’obligation de payer le tribut. Car si je dis « c’est moi qui ai le pouvoir et c’est vous qui le subissez », il faut que je le prouve ; et je le prouve en vous obligeant à payer le tribut, c’est-à-dire à détourner une partie de votre activité à mon profit exclusif. De par là même, je ne suis pas seulement celui qui a le pouvoir, mais celui qui exploite les autres ; et il n’y a pas de machine étatique sans cette institution qui s’appelle le tribut. Le premier acte de l’homme de pouvoir, c’est exiger tribut, paiement de tribut de ceux sur qui il exerce le pouvoir.
Alors, vous me direz : « Pourquoi obéissent-ils ? Pourquoi payent-ils le tribut ? » Ça, c’est la question de l’origine de l’État, justement. Je ne sais pas très bien, mais il y a dans la relation de pouvoir quelque chose qui n’est pas seulement de l’ordre de la violence. Ce serait trop facile, parce que ça résoudrait le problème tout de suite ! Pourquoi y a-t-il l’État ? Parce que à un moment donné, ici ou là, un type ou un groupe de types disent : « Nous avons le pouvoir et vous allez obéir. » Mais là, deux choses peuvent se passer : ou bien ceux qui entendent ce discours disent « oui c’est vrai, vous avez le pouvoir et on va obéir » ou bien « non, non, vous n’avez pas le pouvoir et la preuve, c’est qu’on ne va pas vous obéir » et ils pourront traiter les autres de fous ou on va les tuer. Ou bien on obéit, ou bien on n’obéit pas ; et il faut bien qu’il y ait eu cette reconnaissance du pouvoir, puisque l’État est apparu ici et là dans diverses sociétés. En fait, la question de l’origine de cette relation de pouvoir, de l’origine de l’État, à mon avis, se dédouble, au sens où il y a une question du haut et une question du bas. La question du haut, c’est : qu’est-ce qui fait que, quelque part à un moment donné, un type dise « c’est moi le chef et vous allez m’obéir » ? C’est la question du sommet de la pyramide. La question du bas, de la base de la pyramide, c’est : pourquoi les gens acceptent-ils d’obéir, alors que ce n’est pas un type ou un groupe de types qui détient une force, une capacité de violence suffisante pour faire régner la terreur sur tout le monde. Donc il y a autre chose ; cette acceptation de l’obéissance renvoie à autre chose. Je ne sais pas trop ce que c’est ; je suis un chercheur... donc je cherche. Mais tout ce qu’on peut dire pour le moment, il me semble, c’est que si la question est pertinente, la réponse n’est pas évidente.
Mais on ne peut pas faire l’économie de la question du bas, c’est-à-dire pourquoi les gens acceptent-ils d’obéir, si l’on veut réfléchir sérieusement à la question de l’origine de la relation de pouvoir, à la question de l’origine de l’État.
C’était déjà là les deux questions que posait Rousseau au début du Contrat social, quand il disait : jamais un homme ne sera suffisamment fort pour être toujours le plus fort, et pourtant il y a État ; sur quoi fonder alors le pouvoir politique ? J’ai eu l’impression, en lisant La Société contre l’État, qu’il y avait une analogie entre ta démarche et celle de Rousseau, avec un point d’ancrage très significatif : la référence à des petites sociétés (je pense aux références de Rousseau à Genève, à la Corse, aux petites vallées suisses) une telle recherche débouchant sur la question de l’origine du pouvoir politique.
Ce n’est pas une recherche. C’est ce que m’apprennent les sociétés primitives... Là, on se déplace un petit peu, mais en fait on est toujours dans le même champ. À quelle condition une société peut-elle être sans État ? Une des conditions est que la société soit petite. Par ce biais-là, je rejoins ce que tu viens de dire à propos de Rousseau. C’est vrai, les sociétés primitives ont ceci en commun qu’elles sont petites, je veux dire démographiquement, territorialement ; et ça, c’est une condition fondamentale pour qu’il n’y ait pas apparition d’un pouvoir séparé dans ces sociétés. À ce point de vue-là, on pourrait opposer terme à terme les sociétés primitives sans État et les sociétés à État : les sociétés primitives sont du côté du petit, du limité, du réduit, de la scission permanente, du côté du multiple, tandis que les sociétés à État sont exactement du côté du contraire ; elles sont du côté de la croissance, du côté de l’intégration, du côté de l’unification, du côté de l’Un. Les sociétés primitives, ce sont des sociétés du multiple ; les sociétés non primitives, à État, ce sont des sociétés de l’Un. L’État, c’est le triomphe de l’Un.
Tu viens d’évoquer Rousseau ; on pourrait en évoquer un autre, qui s’est posé la question fondamentale, celle que je posais il y a un instant, à savoir ce que j’appelais la question du bas : pourquoi les gens obéissent-ils, alors qu’ils sont infiniment plus forts et plus nombreux que celui qui commande ? C’est une question mystérieuse, en tout cas pertinente, et celui qui se l’est posée il y a très longtemps et avec une netteté parfaite, c’était La Boétie dans Le Discours de la servitude volontaire [1]. C’est une vieille question, mais ce n’est pas parce que c’est une vieille question qu’elle est dépassée. Je ne pense pas qu’elle est du tout dépassée ; au contraire il est temps de revenir à cette question-là, c’est-à-dire sortir un peu du marécage « marxiste », qui rabat l’être de la société sur, parlons massivement, l’économique, alors que peut-être il est plutôt dans le politique.
Tu disais que tu rencontrais naturellement le problème du marxisme. Est-ce que tu ne rencontres pas aussi la grille de lecture psychanalytique et pourquoi est-ce que tu n’y fais pas référence ?
Là, c’est autre chose. Je dois dire que je suis quasiment analphabète en ce qui concerne la littérature psychanalytique. Donc, l’absence de référence vient de l’absence de culture. Et deuxièmement je n’en ai pas besoin. Je n’ai pas besoin de faire référence à la lecture, à la grille psychanalytique pour ce que je cherche. Peut-être que, ce faisant, je me limite ou je perds du temps, mais jusqu’à présent je n’en ai pas eu besoin. Et je dois dire que d’autre part les quelques lectures que j’ai eues de textes qui sont à cheval sur l’ethnologie et la psychanalyse ne m’ont pas encouragé à aller dans cette direction. Lorsque, parlant de la question du pouvoir, je parle du désir de pouvoir, ou à l’autre bout, c’est-à-dire en bas, du désir de soumission, je sais bien que « désir » ça fait partie du vocabulaire et de l’arsenal de concepts de la psychanalyse ; mais enfin, je peux très bien avoir pris ça chez Hegel ou même chez Marx, et en fait mes références sont plutôt de ce côté-là. Très simplement, là, je ne sais pas grand-chose ; je ne sais presque rien pour ce qui est de la psychanalyse, et puis ça ne me manque pas. Naturellement, si un jour il me semble que j’arrive à une impasse et que la grille psychanalytique me permette d’en sortir, alors là, je ferai un effort... Mais pour le moment, non, je n’ai pas besoin de cet instrument-là ; je pense au contraire que ça me brouillerait les idées ; les idées, c’est pas grave, mais ça brouillerait la réalité.
Tu dis que le fondement de la distinction entre société primitive et société non primitive, c’est la division dans un cas, la non-division dans l’autre. Mais il me semble que si la division riche/pauvre, exploiteur/exploité n’existe pas par exemple chez les Guayaki, il existe un autre type de division, ne serait-ce que homme/femme, bien sûr, et normaux/déviants. Dans la Chronique des Indiens guayaki, par exemple, tu as pris le cas de deux pédérastes, il y en a un qui s’adapte aux normes et l’autre non. Quelle sorte de pouvoir s’exerce sur lui pour lui faire sentir que sa position est anormale ?
Là on est loin, on s’écarte. Quelle sorte de pouvoir ? Comment dire... le point de vue du groupe, le point de vue de la communauté, l’éthique de la société. Là, c’est un cas précis : les Guayaki, c’est, c’était, puisqu’il faut en parler au passé, une société de chasseurs. Alors là, un bonhomme qui n’est pas un chasseur, c’est presque un moins que rien. Donc le type, il n’a pas tellement le choix ; n’étant pas chasseur, pratiquement il n’est plus un homme. Il n’y a pas un chemin très grand à parcourir pour aller de l’autre côté, c’est-à-dire dans l’autre secteur de la société, qui est le monde féminin. Mais je ne sais pas si on peut parler en termes de pouvoir. En tout cas, ce n’est pas un pouvoir au sens où on en a parlé jusqu’à présent, un pouvoir de nature politique.
Un pouvoir non coercitif ? Mais est-ce que le fait de ne pas repérer un pouvoir qui soit cristallisé sur un bonhomme ne te fait pas dire que c’est une société sans pouvoir, parce que, justement, il n’est pas cristallisé sur quelques individus ? Mais il existe quand même bien une division, une réprobation sociale, qui fait que les individus ne se comportent pas n’importe comment. Ainsi, dans les relations matrimoniales, le type qui refuse que sa femme ait un second époux (Chronique des Indiens guayaki), finalement, il rentre dans le rang au bout d’un certain temps. Alors le pouvoir existe quand même puisqu’il y a des normes de comportement ?
Ce sont des normes soutenues par la société entière, ce ne sont pas des normes imposées par un groupe particulier à l’ensemble de la société. Ce sont les normes de la société elle-même ; ce sont les normes à travers lesquelles la société se maintient ; ce sont les normes que tout le monde respecte ; elles ne sont imposées par personne. Les normes dans les sociétés primitives, les interdits, etc., c’est comme les lois chez nous, on peut toujours transiger un petit peu. Mais enfin là, ce ne sont pas les normes d’un groupe spécial de la société, qui les impose au reste de la société ; c’est les normes de la société elle-même. Ce n’est pas une question de pouvoir. D’ailleurs pouvoir de qui ? Sur qui ? C’est le pouvoir de la société prise comme un tout unitaire, puisqu’elle n’est pas divisée, c’est le pouvoir de la société comme un tout sur les individus qui la composent. Et ces normes, comment sont-elles apprises, acquises, intériorisées ? Par la vie, l’éducation des enfants, etc. On n’est pas dans le champ du pouvoir. De la même manière que le « pouvoir » d’un père sur ses enfants, dans la société primitive, ou d’un mari sur sa femme, ou s’il en a plusieurs sur ses femmes, n’a rien à voir avec cette relation de pouvoir que je place comme essence de l’État, de la machine étatique. Le « pouvoir » d’un père sur ses enfants, cela n’a rien à voir avec le pouvoir d’un chef sur les gens qui lui obéissent ; ça n’a rien à voir. Il ne faut pas confondre les domaines.
Il y a une division de l’espace, qui est généralement posée comme déterminante chez Henri Lefebvre et les situs, c’est la division ville/campagne. Dans la Chronique des Indiens guayaki et surtout dans le chapitre « L’arc et le panier » de La Société contre l’État, tu fais apparaître une autre division entre espace masculin et espace féminin. À quoi renvoie cette division ?
C’est normal qu’il y ait cette division dans ce cas. N’oublions pas qu’il s’agit de chasseurs nomades ; c’est normal qu’il y ait deux espaces assez bien différenciés, car la chasse, c’est une affaire d’hommes et ça se fait dans la forêt. C’est un domaine de forêts de toute façon, tout le monde est dans la forêt ; mais il y a une distinction entre le campement où on s’arrête, où on dort, où on mange, etc., qui est l’espace de tout le monde (les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards...), et la forêt, qui est très marquée par ceux qui y passent leur temps, qui sont les hommes en tant que chasseurs. Il se trouve que, à part ça, en raison de la composition démographique des Guayaki, les femmes étaient plus nombreuses que les hommes ; donc le campement était plus marqué du côté des femmes que du côté des hommes ; d’autant plus que les hommes, ils s’en vont à la chasse entre hommes, et que les femmes restent avec les enfants au campement. Donc, sans pousser trop loin cette opposition, on peut en effet distinguer deux espaces : la forêt, c’est l’espace de la chasse, du gibier et des hommes en tant que chasseurs ; le campement, c’est plutôt l’espace féminin, avec les enfants, la cuisine, la vie familiale, etc. Ceci dit, on n’a pas là quoi que ce soit qui rappelle une quelconque relation de pouvoir des uns sur les autres.
En fait, l’espace divisé entre ville et campagne est un espace hiérarchisé, autoritaire. Ici, il n’y a pas un rapport identique de hiérarchie entre les deux espaces ?
Non, pas du tout ! Même si on prend d’autres cas, parce que là c’est un cas spécial, c’est des chasseurs nomades (après tout, c’est très rare une société de chasseurs nomades, ou plutôt c’était très rare...), même si on prend le cas le plus courant qui est celui des sociétés primitives d’agriculteurs sédentaires (c’était le cas de la quasi-totalité des Indiens d’Amérique du Sud, et je ne parle pas des Andes, je parle des Indiens de forêt, les sauvages-à-plumes-tout-nus, l’Amazonie quoi... presque tous sont des agriculteurs sédentaires, même s’ils vont à la chasse, s’ils pêchent, s’ils cueillent... ce sont des agriculteurs sédentaires), il n’y a aucune distinction entre le village, comme première image de la ville, et la campagne. Ça n’a strictement rien à voir.
La distinction ville/campagne apparaît quand il y a la ville, avec des gens qui ne sont pas des villageois, parce que villageois, ça correspond à village, mais qui sont des bourgeois, des gens qui habitent le bourg, avec des chefs. C’est là où habitent les chefs d’abord. La ville et la distinction ville/campagne apparaissent avec et après l’apparition de l’État, parce que l’État, ou la figure du despote, se fixe tout de suite dans un centre, avec ses forteresses, ses temples, ses magasins... Alors là, forcément, il y a une distinction entre le centre et le reste ; le centre, ça devient la ville, et le reste, ça devient la campagne. Mais cette distinction-là ne fonctionne pas du tout dans une société primitive, même si on a des communautés primitives qui ont une taille considérable. La dimension n’y change rien : qu’on ait affaire à une bande de chasseurs guayaki de trente personnes ou à un village guarani de mille cinq cents personnes, il n’y a absolument pas la distinction ville/campagne. Ville/campagne, c’est quand l’État est là, quand il y a le chef, et sa résidence, et sa capitale, et ses dépôts, ses casernes, ses temples, etc. Les villes sont créées par l’État ; c’est pour ça que les villes, les cités sont aussi anciennes que l’État : là où il y a État, il y a ville ; là où il y a exercice de la relation de pouvoir, il y a distinction ville/campagne. Forcément parce que tous les gens qui habitent dans la ville autour de celui qui commande, il faut bien qu’ils mangent, il faut bien qu’ils vivent, et alors ce sont les autres, ceux qui sont hors de la ville, ceux qui sont dans la campagne qui travaillent pour eux. D’ailleurs, c’est pour ça qu’on pourrait même dire que la figure du paysan, en tant que tel, apparaît à l’intérieur de la machine étatique, le paysan étant celui qui vit et travaille dans la campagne partiellement au profit de ceux qui sont dans la ville et qui commandent, c’est-à-dire qu’il paie le tribut, il paie le tribut sous forme de services personnels qui sont soit des corvées, soit des produits de ses champs... Mais le tribut, à quoi sert-il ? Il sert d’abord à marquer le pouvoir, c’est le signe du pouvoir ! Il n’y a pas d’autre moyen de manifester le fait du pouvoir. Cela ne peut passer que par le tribut. De quelle manière, moi disant « je suis le chef, j’ai le pouvoir », vais-je le manifester ? En vous demandant quelque chose, ce quelque chose, ça s’appelle le tribut. Le tribut c’est le signe du pouvoir et en même temps c’est le moyen d’entretenir, d’assurer la permanence de la sphère du pouvoir, de tous ceux qui entourent le chef. Et la bureaucratie se gonfle très vite à partir du moment où il y a un chef, un despote : il est très vite entouré de gens qui assurent son pouvoir, des gardes du corps, des guerriers. Ils peuvent se transformer très rapidement en fonctionnaires spécialisés pour aller ramasser le tribut, ou le comptabiliser, le compter, en statisticiens, en prêtres, enfin toute la constellation des soldats, des fonctionnaires, des scribes, des prêtres apparaît très vite avec la figure, autour de la figure du chef.
Il suffit que le champ d’application de la relation de pouvoir soit un peu vaste ; alors à ce moment-là, il y a tout de suite tout ce qui entoure la figure du chef : les prêtres, les militaires, les scribes, les fonctionnaires, les inspecteurs, etc., et une vie de cour, une aristocratie. Tous ces gens-là ne vont pas travailler, parce qu’ils ont en fait autre chose à faire, ce n’est même pas par paresse, par désir de jouissance comme le maître chez Hegel, mais parce qu’ils ont autre chose à faire, ils ont à être prêtres, généraux, fonctionnaires, etc. Ils ne peuvent pas en même temps cultiver les champs, élever des troupeaux, donc il faut que les autres travaillent pour eux.
Il y a des sorciers dans la société primitive, des chamans. Comment rendre compte de leur place ?
Là on revient un peu à ce dont on parlait tout à l’heure, des ambiguïtés du terme de pouvoir.
Oui, je crois qu’en fait un certain nombre de nos questions jouent sur ce type d’ambiguïté, à savoir : coercition qui assure la cohésion sociale et d’un autre côté pouvoir politique ; et il me semble que tu distingues très nettement les deux, alors que ça nous apparaissait moins clairement. C’est peut-être ce point-là qui nous a le plus « choqués » dans l’ensemble des questions qu’on a pu se poser.
D’abord, tu dis coercition ; il n’y a pas de coercition dans les sociétés primitives.
Par exemple, la nécessité de rendre, de donner et de rendre, de recevoir et de rendre.
L’échange et la réciprocité ! Il serait absurde de nier, disons, l’obligation d’échanger, d’échanger des biens ou des services, comme celle d’échanger les femmes pour respecter les règles matrimoniales, et d’abord la prohibition de l’inceste, mais l’échange des biens qui se passe tous les jours, qu’on voit, c’est celui de la nourriture principalement, d’ailleurs on ne voit pas très bien ce qui pourrait circuler d’autre. Cela se passe entre qui et qui ? Quelles sont les personnes englobées dans ce réseau de circulation des biens ? Ce sont principalement les parents, la parenté, ce qui implique non seulement les consanguins mais aussi les alliés, les beaux-frères... C’est une obligation, mais à peu prés de la même manière que c’est chez nous une obligation de faire un cadeau à un neveu ou de porter des fleurs à une grand-mère. En plus c’est le réseau qui définit ce qu’on pourrait appeler les assurances sociales. Sur qui un individu d’une société primitive peut-il d’abord compter ? C’est sur sa parenté. La manière de montrer qu’on escompte, éventuellement, en cas de besoin, l’aide des parents et des alliés, c’est de leur offrir de la nourriture, c’est un circuit permanent de petits cadeaux. Ce n’est pas compliqué ; quand les femmes font la cuisine, quand la viande ou n’importe quoi d’autre est prêt, on voit, en effet, tout de suite, la femme elle-même, ou un enfant qu’elle envoie, porter une petite quantité, quasiment symbolique, d’aliments — ça ne constitue pas un repas — à telle personne, telle personne, telle personne, etc. Ce sont presque toujours des parents ou des alliés, pourquoi fait-on cela ? Parce qu’on sait qu’eux-mêmes feront la même chose, on pourra compter sur ces gens-là, en cas de besoin, de catastrophe... ce sont les assurances, la sécurité sociale. C’est une sécurité sociale qui n’est pas d’État, elle est de parenté. Mais il ne viendrait jamais à l’idée d’un sauvage d’offrir quoi que ce soit à quelqu’un dont il n’a rien à attendre. Ça ne lui viendrait pas même à l’esprit ! C’est pour cela que le champ des échanges est rabattu, je ne dis pas exclusivement mais principalement, sur les réseaux d’alliance et de parenté. Maintenant, il peut y avoir naturellement d’autres types d’échange qui, eux, ont une fonction différente, qui sont plus ritualisés, et qui concernent, par exemple, les relations d’une communauté avec une autre communauté : alors là, on est dans l’ordre des « relations internationales » en quelque sorte. Ces échanges interparentaux et interalliés, dont je parlais, se passent à l’intérieur de la communauté.
Tu parlais tout à l’heure du chaman : en effet, le chaman (il n’y a pas de doute), c’est probablement l’homme qui a, disons, le plus de pouvoir. Mais qu’est-ce que son pouvoir ? Ce n’est pas du tout un pouvoir de nature politique ; je veux dire, le lieu où il est inscrit dans la société, ce n’est pas du tout un lieu à partir duquel il peut dire : « Je suis le chef, donc vous allez obéir. » Absolument pas. Il y a des chamans, selon les groupes, qui ont une plus ou moins grande réputation, selon qu’ils sont plus ou moins grands chamans. Il y a des chamans qui ont une réputation formidable, c’est-à-dire dont la réputation s’étend très loin chez des groupes qui ne le connaissent même pas. Le chaman, en tant que médecin, c’est-à-dire en tant que maître des maladies, est maître de la vie et de la mort : s’il soigne quelqu’un, il met la maladie, il enlève la maladie du corps du patient ; il est maître de la vie. En tant que tel il soigne et il guérit. Mais en même temps il est forcément maître de la mort, c’est-à-dire qu’il manipule les maladies, et s’il est capable d’arracher la maladie... ou plutôt d’arracher une personne à la maladie, inversement il est capable de jeter la maladie sur quelqu’un. Ce qui fait que le métier de chaman n’est pas un métier de tout repos, parce que si quelque chose d’anormal arrive dans la société (soit que le chaman échoue plusieurs fois dans ses cures, soit que quelque chose d’autre se passe), le chaman fonctionnera, de préférence, comme bouc émissaire dans la société. Le chaman sera rendu responsable de ce qui se passe, des choses anormales qui se passent dans la société, des choses qui font peur et qui inquiètent les gens, c’est lui qu’on va rendre responsable en raison du fait qu’en tant que maître de la vie il est maître de la mort. On dira : « c’est lui », c’est lui qui jette des sorts, c’est lui qui rend les enfants malades, etc. Que fait-on dans ce cas-là ? Eh bien, le plus souvent, le chaman est tué ! Il est tué.
C’est pour cela que je disais tout à l’heure que le métier de chaman, ce n’est pas un métier de tout repos. Mais, en tout cas, le prestige et le respect dont peut bénéficier le chaman dans une tribu ne lui donnent pas la moindre possibilité de fonder l’État, de dire : « C’est moi qui commande » ; il n’y penserait même pas.
Son prestige n’est-il pas sujet à caution ? Ce n’est pas nécessairement un personnage, disons, sacré. Dans les deux « contes » que tu rapportes sur les chamans, on se moque d’eux…
Mais les chamans ne sont pas du tout dans le sacré. Les Indiens ne sont pas du tout par rapport au chaman comme l’Indien des Andes, autrefois, par rapport à l’Inca ou comme le chrétien, ici, devant le Pape. Simplement on sait que si on est malade on peut compter sur lui et on sait aussi qu’il faut faire attention avec ce bonhomme parce qu’il a des pouvoirs, il n’a pas le Pouvoir, il a des pouvoirs, ce n’est pas du tout la même chose. Parce qu’il est aidé par ses esprits assistants (comment et pourquoi est-il aidé par ses esprits assistants ? Parce qu’il a appris : c’est long pour devenir chaman, ça demande des années et des années, disons, d’études), il a des pouvoirs, mais ça ne lui donnera jamais le pouvoir : il n’en veut pas ! À quoi ça lui servirait ? Et puis les gens rigoleraient ! Il ne faut sûrement pas, à mon avis, chercher l’origine du pouvoir dans le prestige du chaman. Ce n’est certainement pas de ce côté-là.
Il est « inspiré »... Y a-t-il un rapport entre le chaman et le prophète ?
Aucun. Cela n’a rien à voir. Les chamans il faut voir exactement ce qu’ils sont : des médecins. Ils soignent les gens et en même temps ils tuent les ennemis. Un chaman soigne les gens de sa communauté, il soigne, si on le lui demande, les gens des communautés alliées, et il tue les ennemis. Il est, en ce sens, un pur instrument de la communauté. Comment tue-t-il ? Il tue comme un chaman, il appelle toute son armée d’esprits assistants et il les envoie tuer les ennemis ; de sorte que, par exemple, dans une communauté x, il y a un enfant qui meurt, ou quelqu’un d’autre, et que le chaman local n’a pas réussi à le soigner. Que vont-ils dire ? « C’est le chaman de tel groupe qui a tué cette personne » ; d’où la nécessité de se venger de faire un raid, etc.
Le chaman c’est ça. Il fonctionne comme médecin pour la communauté et comme machine de guerre au service de sa communauté contre les ennemis. Un prophète ce n’est jamais un médecin, il ne soigne pas. D’ailleurs, pour prendre l’exemple de l’Amérique du Sud, il y a eu des prophètes chez les Tupi-Guarani, mais tous les chroniqueurs font parfaitement la différence entre les chamans d’un côté, qui sont sorciers, médecins, et les prophètes de l’autre. Les prophètes parlent, ils font des discours de communauté en communauté, de village en village. Ils s’appellent d’un nom particulier : les caraï ; tandis que les chamans s’appellent les paji. La distinction est parfaitement claire. Je pense même qu’on peut aller un peu plus loin et dire que les prophètes ne sont pas d’anciens chamans. C’est une figure vraiment différente.
Dans une note, en bas de page des Mémoires de Geronimo [2], celui-ci est défini comme chaman de guerre. Qu’est-ce que cela peut-il vouloir dire ?
Je n’en sais rien. Cela n’a qu’une importance secondaire. Geronimo était un chef de guerre. C’est possible qu’en même temps il ait eu quelques talents de chaman, connu des chants spéciaux. Mais c’était un chef de guerre, principalement.
On pourrait reprendre cette question de la guerre, à savoir : quel est le statut de la guerre dans les sociétés primitives ? Ce qui nous ramène au problème de savoir s’il faut parler de sociétés isolées, ou d’ensembles de sociétés, de rapports intergroupes. La guerre est-elle un phénomène exceptionnel ou, finalement ne fait-elle pas partie de la quotidienneté, de la vie de la communauté ? Dans la mesure où l’on parle du rôle de chef au moment de la guerre, qu’est-ce que cela peut vouloir dire ? Est-ce un phénomène exceptionnel ou n’est-ce pas à l’horizon de toute la vie sociale ?
C’est certain ; la guerre est inscrite dans l’être même des sociétés primitives. Je veux dire que la société primitive ne peut pas fonctionner sans la guerre ; donc la guerre est permanente. Dire que dans la société primitive la guerre est permanente ne veut pas dire que les sauvages se font la guerre du matin au soir et tout le temps. Quand je dis que la guerre est permanente, je veux dire qu’il y a toujours, pour une communauté donnée, quelque part des ennemis, donc des gens qui sont susceptibles de venir nous attaquer. L’attaque en question ne se produit que de temps en temps, mais les relations d’hostilité entre les communautés, elles, sont permanentes ; c’est pourquoi je dis : la guerre est permanente, l’état de guerre est permanent.
Pourquoi ? Là, on rejoint ce dont on a parlé tout au début, à propos de la taille des sociétés. Je disais à quelle condition une société pouvait être primitive ? L’une de ces conditions qui est essentielle, c’est la taille de la société, de la communauté, il ne peut y avoir, du moins je le pense, de société à la fois grande et primitive. Pour qu’une société soit primitive, il faut qu’elle soit petite. Pour qu’une société soit petite, il faut qu’elle refuse d’être grande, et pour refuser d’être grande, il y a comme technique, qui est universellement utilisée dans les sociétés primitives et, en tout cas, dans les sociétés américaines, la fission, la scission. Elle peut être parfaitement amicale : quand la société juge, estime que sa croissance démographique dépasse un certain seuil optimal il y a toujours quelqu’un qui propose à un certain nombre de gens de partir. En général, ces séparations suivent des lignes de parenté ; ça peut être un groupe de frères, qui décident d’aller fonder une autre communauté, qui sera naturellement alliée à celle qu’ils quittent puisque non seulement ils sont alliés mais encore ils sont parents. Mais ils fondent une autre communauté, donc il y a ce processus permanent de scission.
Mais au moins aussi important est le fait de la guerre, car la guerre primitive, la guerre dans les sociétés primitives, il faut la voir du point de vue de ses effets. Quels sont les effets de cette guerre permanente, de cet état de guerre permanent dont je parlais ? État de guerre qui devient effectif de temps en temps, là, ça dépend vraiment des sociétés. Toutes les sociétés primitives sont guerrières ou presque, mais elles le sont avec plus ou moins d’intensité : il y a des peuples très guerriers, il y a des peuple qui le sont moins, mais enfin pour tous, en tout cas, la guerre fait partie de l’horizon. Quels sont les effets de la guerre ? Les effets de la guerre sont de maintenir constamment la séparation entre les communautés. En effet avec des ennemis on ne peut avoir que des rapports d’hostilité, c’est-à-dire de séparation : ce rapport de séparation, d’hostilité culminant dans la guerre effective, mais l’effet de la guerre, de l’état de guerre c’est de maintenir la séparation entre les communautés, c’est-à-dire la division. L’effet principal de la guerre c’est de créer tout le temps du multiple, et, ce faisant, la possibilité pour qu’il y ait le contraire du multiple n’existe pas. Tant que les communautés seront, par le moyen de la guerre, dans un état de séparation, de froideur ou d’hostilité entre elles, tant que chaque communauté est et reste par ce moyen-là dans l’autosuffisance, on pourrait dire dans l’autogestion pratiquement, il ne peut y avoir d’État. La guerre dans les sociétés primitives, c’est d’abord empêcher l’Un ; l’Un c’est d’abord l’unification, c’est-à-dire l’État.
Est-ce qu’on pourrait revenir sur les phénomènes de scission ? Tu dis que c’était des sociétés petites et, dès qu’elles croissaient, elles se scindaient. Comment expliques-tu que les sociétés tupi-guarani aient atteint des dimensions assez colossales. Pourquoi ce mécanisme de scission ne fonctionnait-il plus ?
Là, je ne peux pas répondre avec beaucoup de précision sauf sur les chiffres. La particularité des Tupi-Guarani en Amérique du Sud, c’est que les tribus ou les communautés qui constituaient ce que j’appelle la société tupi-guarani étaient d’une taille très considérable, à tel point qu’on est forcé de penser à une espèce d’explosion démographique, toutes proportions gardées, ce n’est pas la Chine ou l’Inde ; explosion démographique qui d’ailleurs a conduit les Tupi-Guarani à une espèce d’expansion territoriale : ils avaient occupé un espace gigantesque. Très probablement parce qu’ils avaient besoin d’espace vital : comme ils étaient à la fois très nombreux et très guerriers, ils partaient et ils chassaient les occupants qu’ils rencontraient, et ils se mettaient à leur place ; ils les chassaient ou ils les tuaient, ou ils les intégraient... je ne sais pas. Mais, en tout cas, ils arrivaient et se mettaient à la place des autres après les avoir mis dehors.
Alors pourquoi cela ? Je veux dire pourquoi y a-t-il chez eux cette remarquable poussée démographique ? Cela, moi, je n’en sais rien. Et ce n’est plus seulement un problème d’ethnologue. C’est un problème qui concerne un tas de gens ; il peut concerner les généticiens, les écologistes… je ne sais pas trop que dire. Mais, en tout cas, ce que je peux dire (ça apparaît de plus en plus au fur et à mesure que des chercheurs s’intéressent aux questions de population dans les sociétés primitives) c’est que, disons, les sociétés primitives sont des « sociétés du codage », pour employer le vocabulaire de L’Anti-Œdipe [3]. Disons que la société primitive, c’est toute une multiplicité de flux qui circulent, ou bien, autre métaphore, une machine avec ses organes. La société primitive code, c’est-à-dire contrôle, tient bien en main tous les flux, tous les organes. Je veux dire par là qu’elle tient bien en main ce qu’on pourrait appeler le flux du pouvoir ; elle le tient bien en main, elle le tient en elle, elle ne le laisse pas sortir ; car si elle le laisse sortir, là, il y a conjonction entre chef et pouvoir ; et là, on est dans la figure minimale de l’État, c’est-à-dire la première division de la société (entre celui qui commande et ceux qui obéissent). Cela, elle ne le laisse pas faire ; la société primitive contrôle cet organe qui s’appelle la chefferie.
Mais il semble bien qu’il y a un flux que la société primitive apparaît parfois comme incapable de contrôler, c’est le flux démographique. On a dit souvent que les sociétés primitives savaient contrôler leur démographie ; tantôt c’est vrai ; tantôt ce n’est pas vrai. Il est évident qu’en ce qui concerne les Tupi-Guarani, au moment où on les connaît, c’est-à-dire dès le début du XVIe siècle, ça ne les dérangeait pas, parce qu’ils étaient en expansion territoriale. Il n’y avait pas de problème. Mais il y aurait eu un problème, par exemple, si, voulant ou plutôt étant obligés d’avoir une expansion territoriale, ils avaient trouvé des adversaires décidés et déterminés pour protéger le territoire qu’ils voulaient occuper. Qu’est-ce qui se serait passé ? Quand il y a ouverture démographique et fermeture territoriale, alors là, il y a des problèmes. Là, il y a quelque chose qui peut-être échappe à la société primitive, la démographie.
Ils ont des tas de techniques pour contrôler la démographie : la pratique constante de l’avortement, la pratique très courante de l’infanticide, la grande quantité de prohibitions sexuelles ; par exemple, tant qu’une femme n’a pas sevré un enfant (le sevrage intervient au bout de deux ou trois ans), presque d’une manière universelle, les relations sexuelles sont interdites entre cette femme et son mari ; si la femme a un enfant (car, comme je le disais tout à l’heure, les prohibitions, les tabous, c’est fait pour être respectés, mais aussi pour être violés), ou est enceinte alors que son premier n’est pas sevré, il y a de grandes chances pour que l’on pratique l’avortement, ou que l’on tue l’enfant dès sa naissance. Malgré ça, il peut y avoir une très considérable croissance de la population sur un horizon, une économie et une écologie sauvage...
Toute une série de questions que nous nous sommes posées tournaient autour du problème du langage : d’un côté le langage est présenté comme à l’origine du pouvoir coercitif (c’est la parole du prophète) et, d’un autre côté, le langage est opposé à la violence.
On est toujours dans cette question du codage. On sait qu’en Amérique (et pas seulement en Amérique, ça aussi apparemment c’est universel) le leader, le chef de tribu, le chef dans la société primitive, il faut qu’il ait diverses qualités qui le qualifient, en vue d’exercer cette fonction ; et, entre autres qualités, il y a la nécessité de savoir parler, d’être un bon orateur. Cela a été constaté constamment. Alors on peut dire que c’est parce que les sauvages aiment les beaux discours ; ils éprouvent du plaisir à entendre un bon orateur ; ce qui est vrai ; ils adorent ça. Mais je crois qu’il faut aller plus loin et que, dans cette obligation qui fait qu’on ne peut pas être reconnu comme chef si l’on n’est pas un bon orateur, il y a quelque chose qui fait que la communauté, qui reconnaît untel comme son leader, elle le piège dans le langage. Elle piège le leader dans le langage, dans les discours qu’il prononce, dans les mots qu’il prononce. Il ne s’agit pas simplement du plaisir d’entendre un beau discours. Mais, à un niveau plus profond et naturellement pas conscient, cela relève de la philosophie politique qui est impliquée dans le fonctionnement même de la société primitive. Le leader, le chef, c’est-à-dire celui qui pourrait être le détenteur du pouvoir, le commandant, celui qui donne des ordres, il ne peut pas le devenir, parce qu’il est piégé dans le langage, piégé au sens où son obligation, c’est de parler.
Tant qu’il est dans le langage, dans ce langage (parce que donner un ordre, c’est aussi parler...), cette obligation d’être bon orateur, il ne peut pas s’en dépêtrer. Au cas où il lui viendrait à l’idée de passer dans un autre type de langage, qui est le langage du commandement (il donne un ordre et l’ordre est exécuté), il ne le pourrait pas. Moi, je ne peux pas comprendre cette obligation d’être un bon orateur autrement que comme un des multiples moyens que se donne la société primitive pour maintenir dans la disjonction chefferie et pouvoir. Tant que le chef est dans le discours et dans ce que j’ai appelé le « discours édifiant », qui est un discours vide, il n’a pas le pouvoir.
Il rapporte l’histoire de la tribu, les raisons qui l’ont faite...
Oui, et c’est un discours profondément conservateur. Mais conservateur de quoi ? De la société, C’est un discours contre le changement, entre autres le changement le plus considérable qui pourrait se passer dans la société primitive : celui qui laisserait apparaître un type qui dise à la société « c’est moi le chef et à partir de maintenant vous allez obéir ». Donc, c’est pour que le chef ne puisse pas dire cela qu’il est un bon orateur, il est maintenant figé, prisonnier dans l’espace du langage. Tant qu’il est dans l’espace du langage, il est à l’intérieur d’un cercle de craie et il ne peut pas en sortir. Il est l’homme qui parle, un point c’est tout.
Et que l’on n’est même pas tenu d’écouter, semble-t-il ?
Non, il n’y a aucune obligation, Si on était obligé de l’entendre, là, il y aurait de la loi ; on aurait déjà basculé de l’autre côté. Il n’y a aucune obligation dans les sociétés primitives, du moins dans les rapports société/chefferie. Le seul qui ait des obligations, c’est le chef. C’est-à-dire que c’est rigoureusement le contraire, le renversement total de ce qui se passe dans les sociétés où il y a l’État.
Le chef, c’est celui qui doit obéir ?
Dans nos pays, c’est le contraire : c’est la société qui a des obligations par rapport à celui qui commande, alors que le chef n’en a aucune, Et pourquoi le chef qui commande, le despote, n’a-t-il aucune obligation ? Parce qu’il a le pouvoir, bien entendu ! Alors, le pouvoir, cela veut dire précisément : « Les obligations, maintenant, ce n’est plus pour moi, c’est pour vous. » Dans la société primitive, c’est exactement le contraire. Il n’y a que le chef qui a des obligations : obligation d’être bon orateur, et non seulement d’avoir du talent, mais de le prouver constamment, c’est-à-dire régaler les gens par ses discours, obligation d’être généreux.
Qu’est-ce que veut dire l’obligation d’être généreux dans des sociétés ou, disons, l’activité économique est autosuffisante au niveau des unités de production ? Les unités de production, ce sont les familles élémentaires (un homme, une femme et les enfants). Elles sont autosuffisantes, c’est-à-dire que chaque unité, en mettant entre parenthèses les petits flux de biens qui sont échangés, n’a pas besoin des autres (ou presque) pour subsister ; d’autre part sa production ne va pas au-delà de ses besoins. Mais pour le chef, c’est bien différent, parce que s’il est obligé d’être généreux, il est obligé (s’il veut remplir son devoir de générosité) de faire aller sa production au-delà de ses besoins. Il est obligé de faire aller sa production en y incluant ses obligations de leader, c’est-à-dire d’avoir toujours un petit stock de diverses choses à mettre en circulation éventuellement, si on lui demande. Donc, être chef ça veut dire faire des discours, pour ne rien dire (si on veut dire ça de manière ramassée), et travailler un peu plus que les autres. Lorsque je dis que dans la société primitive le chef est le seul à avoir des obligations par rapport à la société, on peut le prendre au pied de la lettre ; c’est vrai.
Pourquoi devient-on chef ? Qui devient chef et pourquoi ?
Comment devient-on chef ? D’abord, il faut qu’il y ait un chef. Alors attention ! Je ne suis pas en train de dire : « Il faut qu’il y ait l’État ; si on n’a pas de chef, on est foutu ; il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui commande. » Ce n’est pas ça, puisque le chef ne commande pas, précisément. Mais, auparavant, la machine sociale primitive fonctionne bien, si elle a, je ne sais pas trop comment dire, un porte-parole. Le chef est d’abord un porte-parole, au sens propre. Dans les relations intertribales ou intercommunautaires, il est évident que tout le monde ne va pas parler à la fois, parce que, sinon on n’entend plus rien. Or les relations intertribales sont essentielles, en raison même de l’état permanent de guerre. Quand on a des ennemis, il faut avoir des alliés ; il faut avoir des réseaux d’alliances, et les négociateurs, les porte-parole des communautés, ce sont les leaders, en raison du fait, précisément, qu’ils sont habiles à parler. Mais je pense que l’on pourrait aller un peu plus loin que cela et dire que sans leader la société serait incomplète. Alors, j’ai l’air de me contredire complètement, mais je m’explique tout de suite, en me fondant d’ailleurs sur des données ethnologiques. Une société qui n’aurait pas de leader, de type qui parle, serait incomplète, au sens où il faut que la figure du pouvoir possible (c’est-à-dire ce que la société veut empêcher), le lieu du pouvoir, ne soit pas perdu. Il faut que ce lieu soit défini. Il faut quelqu’un dont on puisse dire : « Voilà, le chef c’est lui, et c’est précisément lui qu’on empêchera d’être le chef. » Si on ne peut pas s’adresser à lui pour lui demander des choses, s’il n’y a pas cette figure-là qui occupe ce lieu du pouvoir possible, on ne peut pas empêcher que ce pouvoir devienne réel. Pour empêcher que ce pouvoir devienne réel, il faut piéger ce lieu, il faut y mettre quelqu’un, et ce quelqu’un c’est le chef. Quand il est chef, on lui dit : « À partir de maintenant, tu es celui qui va être le porte-parole, celui qui va faire des discours, celui qui va remplir correctement son obligation de générosité ; tu vas travailler un peu plus que les autres, tu vas être celui qui est au service de la communauté. » S’il n’y avait pas ce lieu-là, le lieu de l’apparente négation de la société primitive en tant que société sans pouvoir, elle serait incomplète.
Je me rappelle, j’étais il y a trois ans, avec mon copain Jacques Lizot, chez les Indiens yanomami, en Amazonie vénézuélienne ; c’est la région des sources de l’Orénoque, à cheval sur l’extrême sud du Venezuela et l’extrême nord du Brésil, c’est-à-dire que c’est le cœur du système amazonien ; disons que c’est encore une des dernières taches « blanches » de l’Amazonie. Et là vit la dernière grande société primitive au monde certainement, car les Yanomami sont, bien que ça soit assez difficile à évaluer, entre douze mille et quinze mille, ce qui est énorme. Quand on compare avec les chiffres actuels des Indiens d’Amérique. On était dans une petite communauté de cinquante, soixante personnes. Et à la suite de je ne sais quel conflit intracommunautaire, il n’y avait plus de leader. Je ne sais pas ce qu’ils en avaient fait, s’ils l’avaient tué ou si le type avait démissionné si on peut dire, ou si le type était parti. Bref, c’était une communauté sans leader, sans porte-parole. Il n’y avait personne qui pouvait jouer le rôle de chef du protocole, parce que c’est un peu ça... Ils ont eu la visite d’un groupe allié, qui, lui, avait un leader, c’est-à-dire le type qui parlait ; et ce type a fait un très joli discours au groupe qui n’avait pas de leader. Il leur a dit : « Vous êtes moins que rien, vous n’avez même pas de leader, vous n’arriverez à rien. » Il ne voulait pas dire du tout : « Vous avez besoin de quelqu’un qui commande, d’un chef (au sens où on l’entend actuellement). » Il était bien placé, lui, pour le savoir ; il savait très bien qu’il ne commandait pas, mais il était presque agacé de voir ce qu’il voyait, parce que le spectacle n’était pas complet. Il y avait un lieu qui est, on peut le dire, structuralement inscrit dans la société primitive, qui est le lieu de la chefferie, et ce lieu était inoccupé. « Si vous n’avez pas de leader, vous êtes foutus », parce qu’il y avait un vide, une absence ; il manquait un organe.
Je pense que l’organe existe en vue de pouvoir être codé. S’il n’existe pas, alors on ne sait pas trop où le chercher. Il faut qu’on puisse le voir. Si ce lieu-là n’est pas occupé, la société n’est pas complète. Je ne veux naturellement pas dire que s’il n’y a pas de chef, au sens de chef qui commande, rien ne marche. C’est le contraire précisément. Et si le lieu du pouvoir apparent est vide, alors peut-être n’importe quel zigoto va arriver de n’importe où et va leur dire : « C’est moi le chef, je commande. » Ils risquent d’être emmerdés, parce qu’il n’y a plus le chef du protocole, le porte-parole, l’homme qui fait les discours, pour dire : « Mais non, c’est moi. » Et je pense que c’est pour cela que, dans l’anecdote que je viens de vous raconter, le leader visiteur disait aux autres : « Vous n’êtes rien, vous risquez de n’être rien, parce que vous êtes à la merci de n’importe qui, de n’importe quoi. »
Cela se passe un peu comme si la parole était considérée comme potentiellement dangereuse, et qu’en la localisant à un endroit précis, on évite qu’elle devienne dangereuse. Et à ce moment-là, le prophète serait celui qui la prendrait d’ailleurs, d’un ailleurs incontrôlé et incontrôlable ?
Oui, bien entendu. On pourrait dire, en ramassant ça dans une formule, que quand le lieu du pouvoir est occupé, quand l’espace de la chefferie est rempli, il n’y a pas d’erreur possible, la société ne se trompera pas sur ce dont elle doit se méfier, puisque c’est là devant elle. Le danger visible, perceptible, est facile à conjurer, puisqu’on l’a sous les yeux. Quand la place est vide (et elle ne l’est jamais très longtemps), n’importe quoi est possible.
Si la société primitive fonctionne comme machine anti-pouvoir, elle fonctionnera d’autant mieux que le lieu du pouvoir possible est occupé. C’est ce que je veux dire. Donc, au-delà des fonctions quotidiennes que remplit le chef, qui sont ses fonctions presque professionnelles (faire des discours, servir de porte-parole dans les relations avec les autres groupes, organiser des fêtes, lancer des invitations), il y a une fonction structurale, au sens où cela fait partie de la structure même de la machine sociale, qui est qu’il faut que ce lieu-là existe et soit occupé, pour que la société comme machine contre l’État ait constamment sous les yeux le lieu à partir duquel sa destruction est possible : c’est le lieu de la chefferie, du pouvoir, qu’elle a à rendre inexistant (et elle y réussit parfaitement). Et c’est en ce sens que je disais que s’il n’y avait pas ce lieu elle serait incomplète.
La constance du discours et aussi la constance du contrôle du groupe sur le discours du chef, finalement, sont peut-être le moyen de voir s’il ne devient pas fou, enfin s’il ne veut pas accaparer le pouvoir ?
Bien entendu. Tant qu’il fait des discours, et en général c’est, disons, tous les jours ou presque, et tant qu’il fait le même discours, on est tranquille. Parce que, en plus, le chef en tant qu’orateur ne dit jamais des choses différentes de ce que veut entendre la société. Lui-même fonctionne comme organe de maintien de la société (en tant que société sans pouvoir), car ce qu’il dit, c’est un discours qui se réfère constamment aux normes traditionnelles de la société ; c’est le discours « édifiant » : « On a parfaitement vécu comme ça jusqu’à présent, en respectant les normes que nous ont appris nos ancêtres, surtout n’y changeons rien. »
Dans Yanoama (c’est un livre qui est paru dans la collection [4] où j’ai publié la Chronique des Indiens guayaki, il est question des Indiens dont je parlais il y a quelques instants, les Yanomami. C’est absolument passionnant. L’auteur est un Italien, Ettore Biocca, mais en fait, ce n’est pas lui l’auteur ; lui, c’est un escroc. Le vrai auteur est une femme qui s’appelle Helena Valero, une Brésilienne qui a été enlevée par les Indiens yanomami. Cela devait se passer en 1939. Elle avait complètement disparu, et elle a refait surface vingt et un ou vingt-deux ans après, avec quatre enfants. Donc elle a passé plus de vingt ans dans cette société incroyable, et elle s’est échappée. Le livre en question, c’est ce qu’elle a raconté à cet Italien qui n’a pas jugé indécent de signer lui-même le livre, alors que c’est purement cent heures de magnétophone. Bref, il y a un épisode formidable. Elle raconte vingt ans de sa vie là. Cela n’a pas été drôle tous les jours, parce qu’il ne faut pas avoir une vision boy-scout des sauvages. Il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre ce que dit Jaulin, par exemple, sur les Indiens : les intentions sont peut-être bonnes, Mais c’est radicalement faux.
Bref, elle parle longuement de son premier mari. Parce qu’elle est devenue indienne, cette femme a eu deux maris ; elle parle en tout cas de deux maris dans son récit ; et elle parle surtout du premier, pour qui elle éprouvait ce qu’on pourrait appeler de l’amour. Elle en fait un portrait émouvant. Qui était ce type ? C’était un leader, justement. Il l’a prise, elle, comme sa dernière femme. Il en avait quatre à côté. C’était une situation classique : le leader a toujours beaucoup de femmes. Elle a été sa plus récente épouse, et d’ailleurs, visiblement, sa préférée, peut-être du fait qu’elle venait du monde des Blancs : elle avait plus de prestige. Pourquoi ce type était-il leader ? La plupart des leaders yanomami sont des leaders de guerre, des organisateurs de raids. Et c’était un grand leader, un type courageux. Seulement, peu à peu, ce type est devenu fou. Il est devenu paranoïaque et mégalomane : c’est la dynamique de la guerre, c’est le destin des guerriers. Qu’est-ce que veut le guerrier ? Il veut faire tout le temps la guerre. C’est normal, puisqu’il est guerrier. Et peu à peu, au lieu de vouloir faire des guerres qui correspondaient à ce que voulait la société, la tribu dont il était le leader, il a voulu faire la guerre à son propre compte. Il avait un compte personnel, qui ne concernait que lui, avec un groupe. Et il a voulu entraîner sa tribu dans cette guerre-là. Mais cette guerre, ce n’était pas celle de la société.
Alors, qu’est-ce qui s’est passé ? On pourrait dire qu’une des différences entre les sauvages et les autres, c’est que eux, les sauvages, quand ils ne veulent pas faire la guerre, ils ne la font pas ; tandis que nous, quand l’État veut qu’on fasse la guerre, qu’on veuille ou qu’on ne veuille pas, jusqu’à présent en tout cas il fallait y aller ! Qu’est-ce qui s’est passé dans le cas de ce leader ? Les gens l’ont abandonné ; ils l’ont abandonné à tel point que, lui, d’un autre côté, ne pouvait pas perdre la face (parce que c’était un guerrier), il n’allait pas dire : « Bon, puisque vous ne venez pas avec moi, je n’y vais pas non plus. » Un guerrier ne peut pas dire ça. Alors qu’est-ce qu’il a fait ? Il est parti attaquer tout seul et il a été tué naturellement ! C’était un suicide. Mais il était condamné à mort, parce qu’il n’avait pas voulu imposer sa guerre à la société qui n’en voulait pas. Voilà comment on empêche les chefs d’être chefs. Là, il y a un exemple magnifique. C’est ce qui est arrivé constamment à Geronimo, indépendamment du fait que c’était un héros.
Il y a deux aspects : d’une part le fait que Geronimo avait une haine absolument viscérale des Mexicains...
Mais des autres Indiens, des autres Apaches aussi...
Mais il était apparemment plus motivé pour les guerres contre les Mexicains que contre les Américains du Nord...
Parce qu’il avait souffert personnellement, puisque les Mexicains avaient tué sa première famille et sa mère ; mais beaucoup d’autres Apaches aussi...
Mais, d’un autre côté, même quand il partait avec deux ou trois types, s’ils revenaient après s’être fait castagner, ils rentraient penauds et on faisait silence. Mais si c’était une victoire (même s’ils étaient partis à deux ou trois), il y avait une fête. C’était un « désaveu » nettement plus limité que dans le cas du leader yanomami...
Oui, mais là, on peut tenir compte du fait que, probablement, les Apaches savaient très bien qu’ils risquaient d’avoir besoin de lui à un quelconque moment ; après tout, il était très compétent comme guerrier (il l’a assez prouvé).
D’accord, mais à la fois par ses Mémoires et par celles de son neveu Cochise Junior (ça se recoupe assez bien sur pas mal de points), on voit l’image que Geronimo pouvait avoir dans la société apache. Le massacre de sa famille, c’était en 1858. En 1859, c’est la grande razzia de tous les Apaches, comme vengeance. En 59, il y retourne avec deux mecs ; il y a un échec ; tout le monde se tait, on n’en cause pas...
Les deux compagnons ont été tués et lui seul est revenu. En fait, il y avait des tas d’expéditions avec deux ou trois types...
En dix ans, jusqu’en 1868, il y a tous les ans une ou deux expéditions ; mais en 1863, par exemple, il est parti avec trois mecs ; ils ont été victorieux ; et quand ils sont rentrés, ça a été une grande fiesta ; le « désaveu » était limité : on le laissait dans son coin, il faisait ce qu’il voulait, on le considérait un peu comme un marginal, mais pas comme un danger potentiel ?
Qu’est-ce qu’il aurait voulu faire, lui, Geronimo ? Exactement comme ce chef amazonien, dont je parlais il y a un instant. Il aurait voulu qu’à chaque fois qu’il en avait envie les autres en aient envie aussi. Il voulait entraîner avec lui deux ou trois ou quatre cents Apaches, et ils ne voulaient pas.
Mais il n’était pas chef de tribu. Il n’était pas au lieu d’une chefferie.
En effet, ce n’était pas un chef au sens institutionnel ; c’était un chef de guerre et il était connu comme tel à cause de sa compétence technique. C’était un technicien de la guerre, un spécialiste. Alors, quand on avait besoin de lui, on l’appelait. Mais quand il voulait faire sa guerre et qu’il avait besoin des autres, si les autres ne voulaient pas, ils n’y allaient pas ; c’est tout.
Où on le craignait, c’était plutôt de manière indirecte, dans la période des dix ans d’après (dont parle surtout Cochise Junior), car il faisait des razzias et il y avait des chocs en retour, des représailles ; mais au niveau du fait que lui, personnellement, voulait faire sa guerre, il ne me semble pas qu’il y avait une réprobation, on ne le suivait pas ; c’est tout.
C’est ça. Mais dans le cas du guerrier yanomami, il voulait imposer sa guerre à la société ; les gens n’ont pas voulu ; il était le leader d’un groupe assez nombreux (ils étaient entre cent cinquante et deux cents personnes). Je suis passé par ce groupe ; c’était déjà assez considérable. C’est la communauté classique amazonienne. Ils ne l’ont pas frappé ni tué, mais simplement ils lui ont tourné le dos.
Mais alors, je connais un autre cas, dans un autre groupe, d’un type qui était aussi un leader de guerre, qui, lui, est allé beaucoup plus loin. Il commençait, du fait de son prestige, du fait de sa violence (c’était un violent), à diriger sa violence contre les gens du groupe dont il était le leader. Cela a duré un petit moment, puis, un jour, ils l’ont tué. C’était il n’y a pas tellement longtemps (une dizaine d’années), c’est relativement frais. Ils l’ont tué au milieu de la place autour de laquelle est édifié le village, les abris. Ils l’ont tué, tous. On m’a raconté qu’il était percé peut-être de trente flèches ! Voilà ce qu’on fait avec les chefs qui veulent faire les chefs. Dans certains cas, on leur tourne le dos, ça suffit. Si ça ne va pas, on les liquide, carrément. Cela doit être plutôt rare, mais enfin, c’est dans le champ des possibilités du rapport entre la société et la chefferie, Si la chefferie ne reste pas à sa place.
C’est la différence avec Geronimo : il ne semble pas qu’il ait voulu s’imposer. Il disait : « Je pars ; est-ce qu’il y a des mecs qui viennent avec moi ? » C’est tout.
Probablement, il faisait un peu de chantage. On peut très bien imaginer ce qu’il devait leur dire : « Vous êtes des lâches ; les Mexicains vous tuent et vous ne voulez même pas continuer à vous venger » ; et deuxièmement : « Comment ? Vous refusez de me suivre, moi qui vous ai procuré cette victoire totale ? » Parce que en effet, la première fois, ça a été une victoire totale sur les Mexicains. On imagine très bien ce qu’il pouvait leur dire... Maintenant, pensez à d’autres exemples, toujours en Amérique du Nord : les équivalents de Geronimo dans d’autres sociétés, les « grands chefs » de western, Sitting Bull, Red Cloud, et d’autres. C’étaient de très grands leaders, mais qui n’avaient pas un poil de pouvoir. Red Cloud, qui, vers 1865, était capable d’entraîner avec lui un « nuage » de cavaliers sioux (trois ou quatre cents), n’avait pas un poil de pouvoir, au sens de commandement. Il ne commandait rien du tout. Simplement, c’était un type très intelligent. Il faut voir aussi que les leaders, c’est les types les plus intelligents de la communauté, les plus fins, les plus politiques, pour déployer par rapport aux autres communautés, non pas leur stratégie à eux, mais celle de la communauté dont ils sont purement les instruments. Red Cloud, Sitting Bull et autres, on peut dire qu’ils avaient acquis un prestige très grand, mais ils n’étaient pas du tout du côté du pouvoir. Cela n’a rien à voir.
Question plus générale à propos du type d’interrogation que tu peux formuler sur notre société contemporaine, à partir de l’étude des sociétés primitives : n’y a-t-il pas une sorte d’utilisation de la société primitive ? C’est un peu la question posée au début de cet entretien. J’ai cru, à la lecture des textes de La Société contre l’État, apercevoir un certain nombre de références plus ou moins implicites à des gens comme Nietzsche (tu parles du « gai savoir » des Indiens...). Je me demande si la référence aux primitifs ne fonctionne pas comme peut fonctionner dans la pensée de Nietzsche ou celle de Heidegger la référence aux présocratiques, c’est-à-dire à ceux qui sont avant et en même temps à ceux qui sont extérieurs, en ce qu’on ne peut pas penser le passage des présocratiques à Socrate, des primitifs aux « civilisés ». J’ai l’impression qu’il ne s’agit pas seulement d’analogie ou de clin d’œil, mais que ça recouvre autre chose dans ta démarche.
En effet, au moins dans les textes les plus anciens, parce que, là, après tout, il y a un vocabulaire philosophique ; ainsi dans le plus ancien, qui est intitulé « Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne » ; je l’ai écrit en 1962, ça fait un moment ; ceci dit, je n’ai pas grand-chose à y changer. On ne peut pas m’accuser de changer d’idées comme de chemises ! Mais, à cette époque-là, je n’étais pas sorti de la philo, au sens où j’étais étudiant en philo ; je préparais d’assez loin l’agrégation. Et je dois dire que j’étais en effet dans Heidegger. Alors, c’est plutôt des tics qui marquent le moment où je l’ai écrit. Bien que ça ne soit pas toujours que des tics. Quand Heidegger dit : « Le langage est la maison de l’être ; dans son abri, habite l’homme », « L’homme est le berger de l’Autre » [5], on pourrait le dire des sauvages. Il y a dans les sociétés primitives un respect du langage, qui n’existe pas ailleurs. La, il faudrait citer les textes mêmes produits par les sauvages. C’est pour ça, un petit peu, que j’ai fait Le Grand Parler [6], parce que c’est ça.
Les références à Heidegger, Nietzsche, elles sont là. Mais pour le moment, ça ne va pas plus loin. Sauf Nietzsche... Là, je peux reconnaître et affirmer clairement l’influence de Nietzsche, surtout de la Généalogie de la morale, naturellement. Parce que, si je n’avais pas réfléchi un peu sur la Généalogie de la morale, j’aurais eu plus de difficultés à écrire quelque chose comme « De la torture dans les sociétés primitives » (dans La Société contre l’État). C’est sûr. Mais là, la référence n’est plus du tout littéraire et pour faire joli ; elle est sérieuse. On voit bien que quelqu’un comme Nietzsche, qui probablement ne savait rien et se foutait complètement (et il avait raison) de l’ethnologie de son époque. Il y voyait infiniment plus clair que tous les gens de son époque sur la question de la mémoire, de la marque...
Il y aurait une question sur le rapport à la nature. Tu dis d’une part que ce n’est pas déterminant, et d’un autre côté, après avoir lu Pieds nus sur la terre sacrée [7], j’ai eu l’impression qu’ils avaient une attitude radicalement différente de la nôtre par rapport à la nature, une attitude, disons, de respect et un grand étonnement devant le Blanc qui profane allègrement. Est-ce que ça correspond à quelque chose que tu vois, cette différence d’attitude, ou est-ce que ce n’est qu’une différence apparente ?
Pieds nus sur la terre sacrée, ce sont des textes recueillis par McLuhan, avec de belles photos. Je n’ai lu que deux ou trois textes ; il y en a qui sont magnifiques.
Pour revenir à ce dont on parlait avant, voilà un exemple du langage, de la manière dont parlent ces gens. C’est splendide. C’est profondément émouvant. Il faut être un « sauvage » pour parler comme ça. Plus personne ne le fait. C’est impossible de trouver l’analogue aujourd’hui. Sans réduire la question au mode de production, c’est lié, c’est même profondément lié. Le sauvage est un type qui ne saccage pas. Il prend dans la nature ce dont il a besoin. Quand ses besoins sont satisfaits, il s’arrête. C’est précisément toute la question de l’économie primitive. L’économie primitive, comme toute économie, est destinée à satisfaire des besoins. Lorsque le sauvage estime que ses besoins sont satisfaits, il s’arrête d’avoir une activité de production. Par conséquent, il ne va pas couper inutilement des branches d’arbres, ni flécher pour rien un gibier. Jamais il ne fera ça. Il flèche du gibier pour manger de la viande. C’est pour cela que ce n’est sûrement pas les sociétés primitives qui risquaient de détruire le milieu. Ceci dit, on pourrait dire que les sociétés primitives, avec les différences écologiques locales, avaient parfaitement réalisé ce que Descartes voulait : être maître et possesseur de la nature ! Les Indiens d’Amazonie sont parfaitement maîtres de leur milieu, qui est la forêt tropicale. Les Esquimaux sont parfaitement maîtres de leur milieu, qui est la neige et la glace : c’est une économie sans agriculture, par définition ! Les Australiens, les gens du désert, avec très peu d’eau, dans des circonstances écologiques qui nous paraissent, à nous, pas dures, mais impossibles, ils étaient là, ils étaient devenus maîtres du milieu ; je ne dis pas qu’ils n’auraient pas été mieux ailleurs, c’est possible, mais en tout cas, là où ils étaient ils étaient maîtres de leur milieu ; quand ils avaient soif, ils savaient où trouver de l’eau... ils n’étaient pas en panne. D’ailleurs, ce n’est pas compliqué, une société, par définition, elle contrôle son milieu. Pour quelle raison ? Parce que si elle ne le contrôle pas, ou bien elle meurt, ou bien elle s’en va. La société primitive contrôle absolument son milieu, mais elle le contrôle en vue de quoi ? Non pour construire le capitalisme, c’est-à-dire pour accumuler, pour produire au-delà des besoins, elle produit jusqu’aux besoins et elle ne va pas au-delà : ce sont des sociétés sans surplus. Pourquoi ? Pas du tout parce qu’elles ne sont pas foutues de produire, parce qu’elles sont au point zéro de la technique. Les sauvages sont de parfaits techniciens et quand je dis que chaque société est maîtresse de son milieu, je ne le dis pas en l’air : ils savent parfaitement utiliser toutes les ressources du milieu par rapport à leurs besoins. Leurs techniques sont très fines.
Pour prendre des exemples américains, ce sont des gens qui, après tout, dans de nombreuses tribus sud-américaines, avaient une technologie chimique extrêmement raffinée, pour produire du curare, par exemple. Le curare se trouve dans des végétaux, dans des lianes : une liane c’est une liane et le curare c’est un petit flacon de poison qu’on passe sur les pointes de flèches ; eh bien, entre la liane et la petite réserve de poison, il y a un tas d’opérations, il faut des connaissances chimiques ; savoir que c’est de telle liane d’abord, qu’il faut mélanger à d’autres trucs... Je ne vois pas comment on pourrait dire que les connaissances scientifiques des Indiens d’Amazonie étaient inférieures à celles des Européens. Seulement, elles étaient adaptées à leurs besoins.
Dans les grands États, ce qu’on appelle les hautes civilisations (ce qui ne veut rien dire, il n’y a pas de haute et de basse civilisation ; simplement avec le regard européen, les bonnes civilisations, les hautes civilisations sont celles où il y a l’État, c’étaient les Incas, les Aztèques, et le reste c’étaient les basses civilisations, c’est-à-dire inférieures, parce que sans État), on s’étonne qu’il n’y ait pas eu la roue. Ce n’est pas du tout une lacune ou une carence. On dit même que les Aztèques, les enfants aztèques, avaient de petits jouets qui incluaient la roue ; par ailleurs, ils sculptaient des pierres en rond, ils savaient donc parfaitement ce qu’était un cercle, et ils étaient certainement capables de faire rouler un cercle de la même manière qu’ils faisaient rouler des boules, puisqu’ils avaient des jeux de balle. Alors pourquoi n’avaient-ils pas la roue ? Parce que cela ne leur servait à rien. Quand on aborde ces problèmes, je crois qu’il ne faut pas partir de la question « pourquoi », mais de la question « à quoi ça leur aurait servi ». On s’étonne, par exemple, de ce que dans l’Empire inca il y ait eu un système routier fabuleux, incroyable, les Espagnols étaient stupéfaits, ils disaient : « Il n’y a pas l’équivalent chez nous. » Ceux qui étaient instruits parmi eux disaient que ça ressemblait au réseau routier des Romains. Alors un magnifique système routier et pas de roue ! Cela paraît contradictoire, mais c’est normal. À quoi la roue leur aurait-elle servi ? La roue marche principalement avec la domestication des animaux de trait : il n’y avait pas d’animal de trait domesticable dans les Andes ; le seul animal domesticable, et il avait déjà été domestiqué effectivement, c’était le lama. Mais le lama ne peut porter qu’une faible charge, il ne faut pas lui en mettre plus de vingt kilos, et donc l’accrocher à une charrette, cela n’aurait servi à rien. Il peut donc parfaitement y avoir la route et pas de roue. Inversement, quand les sauvages voient quelque chose qui leur est utile, ils le prennent. D’ailleurs, c’est souvent le signe de la fin ; c’est l’histoire du fer en Amérique : l’arrivée du fer a été une catastrophe. Inversement, l’intégration du cheval dans certaines sociétés d’Amérique du Sud et du Nord a été, pendant un moment, une espèce de promotion pour ces sociétés. Mais ce qu’il y a de sûr, c’est que les sociétés primitives résolvent les problèmes qui se posent à elles. Elles les résolvent toujours. Sinon, ce n’est pas compliqué ; une société qui n’arrive pas à résoudre ses problèmes, elle meurt, elle disparaît.
Si je prends les principales propriétés des sociétés primitives, d’abord, on l’a dit au tout début, une société est primitive à condition d’être petite. Peut-être suis-je trop prisonnier de ces références démographiques, mais il me semble que le problème de la population est sans solution. Dans l’Europe occidentale riche et relativement peu peuplée, relativement au tiers-monde, ça peut durer encore quelque temps... mais pour le reste ? J’ai l’impression que pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, qui dure quand même depuis un bon million d’années, pour la première fois ce que l’autre avait dit n’est plus vrai ; l’autre c’est Marx quand il disait « l’humanité ne se pose que les problèmes qu’elle peut résoudre ». Là, il y a des problèmes insolubles, entre autres celui de la croissance démographique. Je n’en sais rien, je me trompe peut-être, mais il me semble que la question de la croissance démographique, qui est toujours supérieure à la croissance de l’alimentation, introduit un décalage qui ne fait, forcément, que s’agrandir. Et c’est ce à quoi on est en train d’assister actuellement, c’est la famine dans le Sahel africain. Vous me direz, c’est la sécheresse. Oui bien sûr, il n’a pas plu pendant des années, mais il y a d’autres problèmes ; et puis, surtout, là où c’est peut-être encore plus grave, parce que là on n’y voit pas de solution, c’est dans le Bangladesh, l’Inde, le Pakistan : quand on voit soit les écologistes, soit les technocrates de la FAO ou du Club de Rome dire la même chose, à savoir que d’ici vingt ans il y a cinq cents millions de personnes qui vont crever de faim en Asie, en Inde, c’est mal parti, et puis c’est sans retour.
C’est pour ça qu’à mon avis, et c’était le point de départ et ce sera le point d’arrivée (je ne veux pas faire de la question de la démographie le deus ex machina qui explique tout, mais je crois que c’est un facteur fondamental) car si on prend ça au sérieux, à savoir que la condition pour qu’une société primitive soit primitive, c’est-à-dire sans État, finalement une société où il y ait le minimum d’aliénation et par conséquent le maximum de liberté, si la condition pour tout cela est qu’elle soit petite, qu’est-ce qui fait d’abord, qu’une société cesse d’être petite ? C’est sa croissance démographique.
D’ailleurs on s’aperçoit, à propos de cette question que, lorsqu’il y a État, il se passe le contre-pied exact de ce qui se passe dans la société primitive. Tout à l’heure on parlait de la guerre, l’État empêche la guerre, l’État empêche l’état de guerre. La guerre du moins change complètement de sens quand on est dans la société à État. L’État empêche la guerre dans le champ où il a le pouvoir, évidemment. Il ne peut pas tolérer la guerre, la guerre civile ; il est là pour garder unitaires les gens sur lesquels il exerce le pouvoir. Mais là on parlait de démographie : tous les États, on peut dire que c’est inscrit, probablement, dans l’essence de l’État, tous les États sont natalistes, tous les États veulent une augmentation quasiment planifiée de la population. Enfin tous les États sont natalistes, tous veulent une population plus nombreuse et certains planifient la démographie ; par un certain côté les empereurs incas n’étaient pas du tout loin d’une planification des naissances, mais dans le sens de l’augmentation, en jouant sur les mariages et sur la quasi-interdiction d’être célibataires. Quand il est interdit d’être célibataire, il faut se marier, et quand on est marié on a de grandes chances de faire des enfants...
Tous les États sont natalistes, forcément, parce que plus la population est nombreuse, plus on a de tributaires, de gens qui paient le tribut, les impôts, plus on a de producteurs ; plus les masses à manipuler sont nombreuses, plus le pouvoir est grand, plus la richesse et la force sont grandes ! C’est pour cela que d’un autre côté on peut dire également que la vocation d’un État, de la machine étatique, pas simplement du type qui la contrôle à un moment donné (c’est dans l’essence même de la machine étatique, me semble-t-il), c’est d’être condamné à la fuite en avant, à la conquête. L’histoire des grands empires, des grands despotes, c’est une conquête permanente, la limite étant une autre machine étatique aussi forte : c’est la seule chose qui puisse l’arrêter, ou des sauvages, des vrais qui ne savent pas et surtout qui ne veulent pas savoir ce que c’est que l’État. L’expansion des Incas, c’est frappant, elle s’est arrêtée à mi-pente des Andes vers l’Amazonie, parce que là commençait le règne des sauvages, des communautés, des tribus, qui n’avaient rien à foutre de payer un tribut à un chef dont ils ne voulaient pas. Mais, sinon, la vocation de toute machine étatique, c’est de s’étendre et, à la limite, de devenir planétaire.
Mais les « sauvages » peuvent-ils apparaître dans la société ?
Si tu entends par « sauvages » les gens dont on a parlé jusqu’ici, c’est-à-dire des gens qui disent « à bas les chefs ! », il y en a toujours eu ! Simplement, cela devient de moins en moins facile de dire ça. Ou plutôt, enfin à mon avis, le destin des États actuels, sous lesquels nous vivons, c’est d’être de plus en plus étatiques, si je peux dire. Et il ne faut pas se laisser avoir par les apparences, ou peut-être même par la volonté sincère de quelqu’un comme Giscard d’Estaing, c’est-à-dire la volonté de libéralisme. Évidemment, Giscard d’Estaing, personnellement, je le trouve plus sympathique que Pompidou ; je raisonne peut-être de manière épidermique, mais enfin j’ai été très content qu’il vire ce trio sinistre Marcellin, Druon, Royer. Mais il ne faut pas se faire d’illusions, indépendamment de la bonne volonté ou pas du type qui, provisoirement, dirige la machine étatique.
La machine d’État, dans toutes les sociétés occidentales, devient de plus en plus étatique, c’est-à-dire qu’elle va devenir de plus en plus autoritaire ; et de plus en plus autoritaire, pendant un bon moment au moins, avec l’accord profond de la majorité, qu’on appelle le plus souvent la majorité silencieuse ; la majorité silencieuse étant certainement très également répartie à gauche et à droite. J’ai été frappé par une enquête, parue dans Le Monde, sur les attitudes des gens par rapport à la propriété privée et donc par rapport à une future société socialiste, où le problème pourrait se poser. Les gens qui sont le plus attachés à la propriété privée et qui la défendraient mordicus, pour 47 pour cent, c’étaient des électeurs communistes. Alors, à mon avis, on ira de plus en plus vers des formes d’État autoritaires, parce que tout le monde veut plus d’autorité. Sitôt que Giscard disparaît pendant quatre heures parce qu’il est avec une petite amie quelque part, c’est l’affolement : où est le chef ? « Il a disparu, on n’est pas commandé ! » La machine étatique va aboutir à une espèce de fascisme, pas un fascisme de parti, mais un fascisme intérieur.
Quand je disais la machine étatique, il ne s’agissait pas seulement de l’appareil d’État (le gouvernement, l’appareil central d’État). Il y a des sous-machines, qui sont de véritables machines d’État et de pouvoir, et qui fonctionnent, en dépit parfois des apparences, en harmonie avec cette machine centrale d’État. Je pense aux partis et aux syndicats, principalement au PC et à la CGT. Il faut analyser le PC et la CGT (je quitte un peu mon terrain, car on n’est plus chez les sauvages) ; il faut les analyser comme des organes très importants de la mégamachine étatique. Je veux dire par là que la société, telle qu’elle est actuellement, aurait le plus grand mal à fonctionner s’il n’y avait pas ce fantastique relais de pouvoir et de colmatage, qui peut aller même jusqu’à l’abus de pouvoir, que constitue l’appareil du PC et de la CGT ; il ne faut pas les séparer : ce sont des formations produites par la même société et, en fait, il y a une profonde complicité de structure, je ne veux pas dire qu’ils se téléphonent le soir pour se demander : « Alors, comment ça a été aujourd’hui ? » ; il y a une profonde complicité de structure entre Marchais et Séguy et les princes qui nous gouvernent. C’est évident. Et après tout, le parti, quel qu’il soit, que veut-il ? Il veut occuper le pouvoir ; il est déjà prêt à prendre la machine en mains.
Je n’ai pas l’impression que la société soit de plus en plus cohérente et de plus en plus rationnelle. Cela, c’est la vision de la science-fiction, à la limite, qui nous fait voir l’évolution de la société vers Le Meilleur des mondes ou vers 1984. Mais je me demande dans quelle mesure on n’assiste pas, au contraire, au morcellement, à une juxtaposition d’oppositions qui ne débouchent pas, dont on ne peut pas rendre compte, disons, en se référant à un appareil qui fonctionnerait, dont on ne peut pas non plus rendre compte comme apparition d’une nouvelle structure au sein de la société. C’est vraiment le morcellement. Reprenons l’exemple de l’école ; il y a une vision de l’école comme appareil idéologique (Althusser), tu as vu le texte « Non, l’école n’est pas malade » (L’Anti-mythes n° 5). J’ai l’impression que ce que nous disons ne renvoie pas exactement au même type de problématique que la tienne.
Je pense qu’on est proches, et ce n’est pas pour faire le radical-socialiste, en rapprochant les points de vue de manière artificielle. C’est parce qu’il y a du morcellement, qu’il y a plus de centralisme ; il me semble que c’est complètement lié. Le capitalisme contemporain se déglingue visiblement, il fonctionne au jour le jour. Mais c’est parce que ça se déglingue, et que ça pète par ici, par là, à la périphérie souvent du système, que le système tend à devenir de plus en plus systématique ou autoritaire.
Tout à l’heure, je n’avais pas dit que l’État était de plus en plus totalitaire ; j’avais dit : l’État tend à devenir de plus en plus étatique. Tu me diras qu’à un moment donné, si l’État devient le tout, on est dans le totalitarisme ! C’est évident. Le risque n’est absolument pas à exclure d’ailleurs. Mais je pense que c’est parce qu’il y a de plus en plus de failles, ici et là, qu’il y a de plus en plus d’« anti-faille », c’est-à-dire d’État. L’État peut très bien récupérer les trucs, par exemple l’avortement. Avant, les femmes n’étaient pas maîtresses d’elles-mêmes, de leur corps, comme on dit, à cause de l’État, parce que l’État ne voulait pas, parce qu’il y avait des lois. Et ne pas respecter la loi, c’est être hors la loi ; être hors la loi, c’est être jugé et être mis en prison. Maintenant, les femmes peuvent être maîtresses d’elles-mêmes, mais il n’y a pas capitulation de l’État. Elles le peuvent grâce à l’État. Avant, il leur disait « vous ne pouvez pas » ; maintenant, il leur dit « vous pouvez ». Mais ce n’est pas une défaite de la machine étatique. Tant mieux que la loi sur l’avortement ait été votée ; sans doute elle est insuffisante... Mais il ne faut pas se faire d’illusions ; ce n’est pas une défaite de la machine étatique ni de la morale bourgeoise : c’est parti d’en haut, même si, grâce à diverses organisations (comme le MLAC), ça n’a pas été seulement d’en haut.
Il suffit de voir les mots d’ordre ; au départ c’était « avortement libre et gratuit », mais c’est devenu « avortement libre et remboursé par la Sécurité sociale ».
Oui, la Sécurité sociale, c’est l’État !

 lavoiedujaguar.net
lavoiedujaguar.net